Les villes pour cible : débats et silences autour
des bombardements aériens de la Seconde Guerre mondiale
Charles S. Maier
Charles S. Maier est professeur d’histoire,
titulaire de la chaire Leverett Saltonstall,
au Centre d’études européennes Minda de
Gunzburg de l’université de Harvard,
Cambridge, États-Unis.
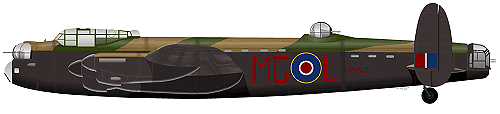
Résumé
Cet article nous reporte aux premiers débats qui ont eu lieu sur la moralité des bombardements des villes avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Il tente d’analyser à la fois l’argumentaire moral et son contexte historique, des années 1940 à nos jours. La doctrine des « dommages collatéraux », qui admettait que l’attaque des usines ennemies était acceptable même si elle coûtait la vie à des civils et détruisait leurs maisons, a été vite étendue au-delà de son sens originel. Après la guerre, le largage de la bombe atomique est devenu un sujet en soi, à distinguer du recours antérieur au bombardement traditionnel, même si le bombardement traditionnel aboutissait à des résultats tout aussi dévastateurs. La question de savoir quelle force était justifiée à
l’encontre des civils a été marquée par une double inhibition : les réticences des commentateurs allemands à sembler vouloir excuser le IIIe Reich, et la difficulté des Américains à sembler dénigrer ceux qui s’étaient battus dans « la bonne guerre ».
*****
Les questions morales mises en contexte
De longues années durant, les débats sur les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki ont laissé dans l’ombre d’autres débats, axés sur les bombardements « classiques » ayant eu lieu pendant, et même avant, la Seconde Guerre mondiale. Un certain consensus tacite s’était en fait dégagé. D’une part, les bombardements allemands de Madrid à l’automne 1936, les attaques contre Guernica, Varsovie et Rotterdam, le Blitz londonien et le bombardement de Coventry (qui a laissé en ruines la Cathédrale Saint Michel et détruit le centre de la ville) étaient des actes de terreur aveugle ayant précisément pour but premier de terroriser la population. D’autre part, menées avec des
centaines de bombardiers qui pouvaient transporter des cargaisons beaucoup plus lourdes, les campagnes bien plus dévastatrices lancées par les Alliés contre des centres urbains italiens, allemands et, plus tard, japonais (l’assaut massif que Tokyo a subi en 1945 pourrait avoir fait de 100 à 125 000 morts) étaient, quant à elles, des actions militaires légitimes (à l’exception, peut-être, du bombardement de Dresde). Bien qu’ils aient eu des effets bien plus dévastateurs que les raids aériens allemands de 1940, les bombardements massifs des villes et cités du Nord de la France en 1944 ont été eux aussi largement
acceptés en tant que l’une des composantes légitimes de l’effort de guerre.
Les attaques allemandes ont bien sûr été condamnées. Certes, l’on aurait pu reconnaître une certaine légitimité à l’effort de guerre allemand (avis que, toutefois, seuls
les Allemands partagent !). Néanmoins, les bombardements de la Luftwaffe sont souvent apparus injustifiés et excessifs, n’ayant pour but que de terroriser et de démoraliser les populations civiles. Le pilonnage de la ville basque de Guernica a eu peu d’utilité militaire et la victoire des Alliés était déjà en vue lorsque Varsovie et Rotterdam ont été bombardées. Qu’en est-il des raids aériens des Alliés ? Peut-être ont-ils été aussi violents
que les attaques allemandes, mais – a-t-on souvent entendu dire –, ces raids n’étaient que des moyens nécessaires pour atteindre un but valable. Ainsi, après la guerre, le débat sur les moyens utilisés est-il resté longtemps au deuxième plan : l’important, c’était le but à atteindre, et la victoire des Alliés constituait une finalité valable. Le but visé justifiait les moyens engagés, ceux-là mêmes qui étaient pourtant condamnés lorsqu’ils étaient mis au service d’une victoire de l’Axe, la finalité étant, en ce cas, contestable !
Ce qui s’est passé, bien sûr, c’est qu’après être resté si longtemps assoupi, le débat a été finalement relancé. Le présent article replace le débat dans le contexte général et examine les questions qu’il soulève. En raison de la nature même de son objet, le débat doit inclure non seulement un récit historique mais aussi une analyse des questions morales.
La discussion sur les moyens utilisés constitue un débat en deux volets qui est bien souvent assez confus. La guerre est un fléau, et elle est reconnue comme telle. Il
existe cependant toute une gradation, certains fléaux étant plus redoutables que d’autres :
de manière générale, il est admis en Occident que le fléau de la guerre devrait être maintenu à un niveau minimum. Une telle conception impose des limites au recours à la
guerre (jus ad bellum) ainsi qu’à la manière de conduire les hostilités, une fois que la guerre est apparue nécessaire (jus in bello). En général, le concept de « nécessité » sert de licence pour recourir à la guerre et pour employer des moyens désastreux au cours des hostilités. La nécessité reste cependant un critère subjectif. De plus, dans certains cas, la nécessité peut être exclue, aux termes d’un accord international, en tant qu’excuse pour infliger des souffrances aux civils (de tels accords sont cependant rarement respectés).
La guerre implique de mettre en regard les moyens à mobiliser et la finalité recherchée. Cela se fait de plusieurs façons. La doctrine de la « guerre juste » suggère que tant le recours à la guerre que la conduite d’une guerre qui a déjà été décidée doivent être
conformes à certaines normes. Même « propre », une guerre cause inévitablement des morts et des destructions. Par conséquent, tel qu’il est codifié en tant que jus ad bellum ou « droit de faire la guerre », le recours à la guerre doit intervenir en dernière instance, et seulement si le mal qui risque d’en résulter peut être compensé par le bien espéré. Dans la seconde sphère, celle du jus in bello ou « droit dans la guerre », des contraintes sont
imposées à la conduite des hostilités (un certain comportement devant être adopté). Au coeur même des contraintes ainsi imposées résident deux grandes priorités d’ordre moral :
premièrement, la préservation de la distinction entre les civils et les combattants militaires; deuxièmement – et, encore une fois, comme dans le cas du recours à la guerre
– l’invocation de la proportionnalité en tant que but à atteindre (en d’autres termes, le mal provoqué ne devrait pas être disproportionné par rapport au bien censé pouvoir être obtenu). Un État s’estimant lésé ne devrait pas partir en guerre à la légère; une fois engagé dans une confrontation, il ne devrait pas exercer des violences disproportionnées par rapport à la provocation. Inversement, de nombreux militaires, tels que le Général
Sherman, affirment de manière convaincante que le fait d’imposer des restrictions rigoureuses à la conduite de la guerre rend la guerre plus improbable.
Nombre de mesures prises en temps de guerre se sont pourtant aussi heurtées à l’autre priorité morale sous-tendant la conduite de la guerre, à savoir : la distinction à faire entre les combattants et les civils ainsi que, par extension, entre les combattants non
encore désarmés et ceux que leur capture ou leurs blessures ont rendus inoffensifs. En bref, l’injonction est la suivante : ne tuez pas des civils et n’assassinez pas des prisonniers de guerre ou des blessés. S’agissant de tuer des soldats qui, de toute évidence, s’apprêtent
à battre massivement en retraite, la question relève davantage d’une certaine « zone grise ». (Les attaques aériennes américaines contre les colonnes de soldats irakiens désarmés et en fuite lors de la guerre du Golfe, en 1991, ont causé quelque émoi aux États-Unis, mais pas au point de devenir un thème de discussion majeur dans le pays. Les Américains ne se croient pas réellement capables de commettre des crimes de guerre. Si de tels actes se produisent, ce ne sont que des exceptions qui prouvent la règle.) La destruction délibérée de biens civils a également été condamnée, mais avec beaucoup moins de vigueur.
Bien que souvent bafouée, la distinction entre civils et combattants est reconnue depuis l’Antiquité. Thucydide raconte comment la moralité des armées grecques a
dégénéré au cours de la guerre du Péloponnèse. Le « dialogue de Mélios » et la répression de Mytilène suggèrent que les civils de sexe masculin étaient considérés comme étant au minimum des soldats potentiels. On se souviendra toutefois à quel point l’attaque des Thraces contre la ville de Mycalessus est apparue choquante. Les soldats ont « mis à sac les maisons et les temples et massacré les habitants, n’épargnant ni les enfants ni les vieillards, mais tuant tous ceux qui avaient la malchance de croiser leur chemin, les
exterminant, l’un après l’autre, femmes et enfants compris, et même les bêtes de somme
(…) en particulier, ils ont attaqué une école de garçons (la plus grande du lieu) dans laquelle les enfants venaient d’entrer, et ils les ont tous massacrés1 ». Les Annales de Tacite regorgent de récits de ce genre : pendant bien des siècles, et jusqu’à la guerre de
Trente Ans, au XXVIIe, exterminer la population après s’être emparé d’une cité assiégée est resté un acte banal. Un tel comportement était toutefois généralement reconnu comme incorrect de manière assez fondamentale. Cette perception a constitué l’un des fondements de ce que l’on prétendit être le « droit naturel » ou se développa en tant que « droit international ». En Europe, au XXVIIIe siècle, la théorie et la pratique ont tenté de réimposer ce « pare-feu » entre civils et combattants, sans outefois éviter qu’un certain nombre de militaires viennent prétendre qu’une telle distinction n’avait d’autre effet que d’accroître le risque de guerre.
Le problème s’est encore compliqué dans les temps modernes. La technologie des armes a contribué à rendre plus floue encore la distinction entre les civils et les militaires.
Or, si l’on peut dire, le « gommage » s’est produit des deux côtés à la fois. D’une part, à cause des nouveaux armements, il est devenu plus difficile de limiter l’ampleur des pertes humaines et des destructions. Les sous-marins et les torpilles utilisés au cours de la Première Guerre mondiale illustrent particulièrement bien ce phénomène. Si les sous-marins devaient prévenir avant de lancer une attaque, ils deviendraient bien plus vulnérables et bien moins efficaces. Dans une telle situation, les Alliés n’ont pas nié qu’il serait peu commode, pour un sous-marin, de remonter à la surface, de s’adresser aux passagers ou à l’équipage du navire qu’il s’apprête à attaquer, en leur demandant de monter à bord des canots de sauvetage et, seulement à ce moment-là, de détruire ou de capturer le bâtiment ! Les Alliés ont simplement déclaré illégales les attaques lancées sans avertissement préalable contre des navires transportant des civils. Les Allemands ont rétorqué que des pertes civiles étaient dues au blocus mis en place par les Alliés, blocus officiellement contraire aux lois de la guerre qui autorisaient de bloquer l’entrée d’un port, mais non de couper des voies maritimes. Leur argument n’a cependant jamais eu tout à fait la même force, les effets du blocus étant indirects et difficiles à visualiser en tant que conséquence immédiate2. (La même absence de lien de cause à effet a également pesé sur le débat relatif aux sanctions économiques contre l’Irak ou d’autres gouvernements en infraction. Des sanctions qui affectent une population dans son ensemble sont-elles justifiées quand elles sont prises à l’encontre de régimes dictatoriaux qui, suppose-t-on, mettent leur population en esclavage ? Par ailleurs, en 1918, à en juger par les implications de la guerre aérienne qui se révélaient peu à peu, notamment à la suite des raids des Zeppelins sur Londres, la question des dommages causés aux civils devait manifestement être prise en compte.
Étant donné les questions soulevées par les bombardements aériens en général, la question au centre du débat a souvent été non pas : « Dans quelle mesure la nécessité
militaire pouvait-elle justifier les dommages causés aux civils ? » mais « la nécessité militaire a-t-elle réellement joué un rôle ? » En d’autres termes, même si l’on cessait de sous-estimer le problème des pertes civiles, la victoire ne pouvait-elle pas être emportée sans de tels actes de cruauté ? Le débat concernant la bombe larguée sur Hiroshima (et, plus encore, la bombe qui a frappé Nagasaki) a généralement tourné autour d’une seule interrogation : fallait-il lâcher ces bombes pour mettre fin à la guerre ? L’une ou l’autre de ces bombes devait-elle être utilisée afin d’obtenir la reddition japonaise ? Tout au moins, ses partisans pensent-ils que la bombe atomique était vraiment nécessaire pour obtenir la reddition des Japonais en évitant de lourdes pertes américaines3 ? La deuxième bombe était-elle tout aussi nécessaire ? Un laps de temps plus long aurait-il dû s’écouler entre ces deux opérations ?
Si les civils sont (ou ont été) pris pour cible, c’est principalement, bien sûr, parce que la technologie moderne fait jouer aux civils un certain rôle dans la guerre. La
conduite de la guerre étant de plus en plus tributaire de la société dans son ensemble – et, plus spécialement, du rôle joué par la main d’oeuvre dans l’armement d’une nation –, la distinction entre civils et combattants a été mise en question. La guerre moderne dépendait à tel point de la production du matériel militaire dans des sites éloignés des lieux de combat que le concept d’une ligne de front tendait à paraître incongru.
Assurément, une nation belligérante avait le droit de détruire la capacité industrielle de son adversaire, celle-ci semblant vraiment faire partie intégrante de l’effort militaire. Par contre, cette nation avait-elle le droit d’attaquer les civils qui travaillaient dans ces sites
de production ? Il est bien connu que la doctrine des « dommages collatéraux » a tout d’abord été invoquée par les stratèges de l’armée de l’air britannique pour tenter de
donner une réponse à cette question. Il convenait d’accepter les pertes civiles en tant que « produit dérivé » des attaques lancées contre des sites engagés dans la production de guerre, voire dans la production de biens civils en rapport avec les opérations militaires.
Jamais aucun dilemme n’avait requis de telles tergiversations. Certes, la question des combattants ne portant pas l’uniforme s’était déjà posée lors de la guerre de la Péninsule, au début du XXIXe siècle, puis lors de la guerre franco-prussienne de 1870 1871.
Les militaires prussiens insistaient pour que ces combattants, ou « francs-tireurs »,
perdent toute protection (à laquelle les soldats capturés avaient droit en tant que prisonniers de guerre) et puissent être exécutés sur le champ. Par la suite, des conférences tenues à Genève et à La Haye ont tenté de ne pas protéger les soldats irréguliers en tant que tels, mais d’énoncer des principes directeurs visant à différentier, d’une part, les troupes de milices légitimes et, d’autre part, les « francs-tireurs » : il s’agissait
essentiellement d’arborer quelque insigne visible et de porter les armes ouvertement, et non en les dissimulant4. Les « francs-tireurs » n’étaient pas des civils; ils étaient plus proches des espions qui, comme eux, n’annonçaient pas leur présence et, en conséquence,
pouvaient légitimement être exécutés lorsqu’ils étaient découverts. Il n’est pas étonnant que, dans de telles guerres, des commandants peu enclins à l’indulgence aient souvent agi sans trop de précautions. En 1914, la peur des « francs-tireurs » avait conduit les Allemands à commettre massivement des atrocités en Belgique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cependant, les « francs-tireurs » sont devenus des « partisans » ou des
« maquisards » : aux yeux des Alliés britanniques ou américains, ces hommes méritaient d’être reconnus comme combattants, alors qu’aux yeux de la force occupante, ils devaient être exécutés. Certains commandants allemands ont non seulement exécuté des résistants capturés mais aussi exercé des représailles contre les civils (sur le front
occidental, le maréchal Kesselring s’est illustré à ce titre en Italie), et ce problème a rapidement fait passer au second plan la question du sort réservé aux résistants. Après la Seconde Guerre mondiale, les nouvelles instructions mises au point en 1949 ont étendu à suggèrent qu’aucune invasion n’était vraiment nécessaire, ses partisans rétorquent qu’un blocus du Japon
aurait probablement fait plus de morts dans ce pays que la bombe elle-même.
Il n’en demeure pas moins que la politique de représailles se trouve toujours au coeur de la guerre de guérilla : elle semble en effet découler de cette « nécessité » qui, en dépit de toutes les conventions, reste la justification sous-jacente de la violence. Telle qu’elle a été menée pendant le deuxième conflit mondial par les résistants (partisans ou maquisards), puis perfectionnée au cours des guerres de décolonisation, la guerre de guérilla impliquait délibérément la population civile, dont elle utilisait les ressources. Il s’agissait soit d’amener (par conviction ou par force) les civils à soutenir la cause des résistants, soit de rendre un tel soutien trop « coûteux ». La théorie de la guerre de guérilla – que les autorités françaises ont étudiée avec zèle dans les écrits chinois et vietminh – demandait, fondamentalement, que la distinction entre le peuple et l’armée soit effacée.
De fait, l’implication des civils est l’élément qui relie la question de la guérilla ou de la guerre de résistance à la question des bombardements aériens. Il existait cependant des différences. Après tout, les résistants agissaient en ayant l’intention présumée de tuer ou de blesser, et ils menaient leurs actions à partir des champs ou des forêts où ils se cachaient. En quoi était-il justifié (ou injustifié) de bombarder des civils – et leurs familles – qui allaient simplement travailler dans des usines ? Cette question est antérieure aux bombardements. Elle se posait déjà au temps des tirs d’artillerie et, dès 1806, les Britanniques avaient rendu célèbre le concept de bombardement naval d’une ville neutre (bataille de Copenhague). Alors que se terminait la Première Guerre mondiale, les possibilités offertes par les bombardements avaient été reconnues et des principes précisant leur usage avaient été définis. En 1923, un Projet de règles sur la guerre aérienne a été proposé lors d’une nouvelle Conférence de La Haye : si elles
avaient été adoptées, ces règles auraient interdit de bombarder des populations civiles
« qui ne se trouvent pas dans le voisinage immédiat (…) des opérations des forces terrestres ». Des objections ont été soulevées et ces règles n’ont jamais été ratifiées (bien qu’elles aient pourtant été clairement proposées en tant que lignes directrices, dont le rejet devait être argumenté). Tout comme plusieurs généraux de l’armée de l’air américaine pendant une grande partie de la guerre, Neville Chamberlain, en 1938, a semblé éprouver une certaine sympathie vis-à-vis d’un sens de la retenue (bien qu’en 1944, la pratique des Américains ait pu paraître aussi brutale que celle des Britanniques).
Cela dit, les partisans britanniques de la nouvelle arme ne voulaient pas avoir les mains liées. Appuyées par la ferme conviction du général Arthur Harris (surnommé «
Harris Bomber »), qui était persuadé que les bombardements de centres civils
permettraient précisément à l’Angleterre de remporter la victoire, les prises de position du général Hugh Trenchard en faveur du nouveau but de la guerre l’ont emporté sur
certaines hésitations antérieures. En 1928, le général Trenchard a prétendu que l’on pouvait tenter de « terroriser les gens (hommes et femmes) qui fabriquent des munitions afin qu’ils cessent de se rendre au travail », mais que le fait de bombarder de manière indiscriminée une ville « dans le seul but de terroriser la population civile » était « illégitime ». Une telle distinction s’est révélée bien trop ténue pour qu’une stratégie puisse être définie sur cette base. Dans les premiers temps de la guerre, les Britanniques ont poursuivi sur la lancée et, suivant en cela le général Trenchard, ils ont élaboré le
concept des « dommages collatéraux ». Ce concept n’était que l’actualisation de ce que, au temps du Scholasticisme, la doctrine médiévale de la guerre juste avait qualifié de
« double effet ». Si, en dépit des précautions prises pour réduire au maximum les pertes civiles (sachant que de telles précautions étaient nécessaires pour rendre la procédure acceptable), des civils étaient blessés ou tués alors que l’on poursuivait un but militaire légitime (personne ne contestait que le fait de réduire à néant la capacité industrielle de l’ennemi constituait un objectif légitime), un tel objectif était acceptable dans les limites de l’obligation, plus générale, de respecter la proportionnalité.
Il convient de souligner ici que tant le recours à la guerre que la guerre elle-même ne pouvaient être justifiés que si le principe de proportionnalité était respecté. Ce principe établissait un lien entre le jus ad bellum et le jus in bello. En quoi la proportionnalité était-elle réellement un guide utile, spécialement lorsque les résultats n’étaient pas aussi clairement décisifs que le promettaient des partisans des bombardements tels que le
général Harris ou Lord Cherwell ? Il n’est pas question ici de passer en revue les déclarations et les stratégies relatives à la guerre aérienne. Chacun sait qu’en 1945,
Churchill lui-même éprouvait quelques doutes et que, jusqu’à ces dernières années, le général Harris a été écarté de la liste des honneurs dont ont bénéficié les acteurs de la guerre aérienne eux-mêmes. Longtemps auparavant, toutefois, deux idées avaient été
largement acceptées : premièrement, d’une certaine manière, les Américains s’en étaient tenus aux bombardements de précision en tant que stratégie, et ils étaient moralement moins obtus que les Britanniques (en Europe, tout au moins); deuxièmement, les bombardements n’étaient pas vraiment un moyen efficace d’atteindre les buts qui leur étaient assignés.
Certes, l’une et l’autre de ces positions peuvent être contestées. Il est vrai qu’à l’exception (notable) du Général Hap Arnold et de son officier subalterne, Curtis LeMay (surnommé « Bombardons les pour qu’ils retournent à l’âge de la pierre »), transférés pour superviser les bombardements du Japon en 1944-1945, la doctrine militaire
américaine n’a pas prétendu qu’en tant que tels, les bombardements de civils pourraient provoquer une fin rapide du conflit. Les •tats-Unis ont poursuivi les bombardements à grande échelle sous prétexte d’atteindre des objectifs particuliers, industriels ou stratégiques. Des bombardiers américains ont cependant bel et bien participé aux raids sur Dresde; de plus, ils ont continué de bombarder des cibles presque jusqu’aux dernières
semaines de la guerre, alors qu’il était déjà évident que les bombardements ne pourraient jouer qu’un rôle stratégique limité. En théorie, l’interruption des communications ferroviaires pouvait justifier presque chaque attaque; en réalité, cependant, il semble qu’un autre sentiment ait prévalu alors : aucune cible ne devait être épargnée. Un tel argument implicite était doté d’une grande résistance potentielle : il ne prétendait plus
que le moral des civils pourrait s’effondrer; il postulait simplement que plus les destructions seraient nombreuses, plus vite l’effondrement de l’ennemi se produirait. Les
Américains ont, eux aussi, étudié la manière d’obtenir un résultat aussi « heureux » que dans le cas des tempêtes de feu comme celle qui a ravagé Hambourg. De plus, les
Américains ont manifestement poursuivi contre le Japon une guerre aérienne qui visait précisément les villes. Les États-Unis ont choisi des armes – les bombes incendiaires –
conçues pour dévaster complètement des zones urbaines, en sachant que des monuments civils et artistiques seraient forcément détruits au cours de telles attaques.
La question de l’efficacité a été soulevée par les célèbres résultats d’un rapport sur les bombardements stratégiques américains, le United States Strategic Bombing Survey.
Les auteurs (John Kenneth Galbraith, en particulier) estimaient que les bombardements stratégiques avaient eu un impact bien moindre qu’on ne l’avait prétendu. Selon le
rapport, la production industrielle allemande avait continué de croître jusqu’à l’automne 1944, les voies ferrées et mêmes les usines avaient été rapidement réparées, et le moral de la population n’avait pas été sérieusement affecté. Les conclusions du rapport ont été
longtemps acceptées, et elles ont été utilisées par ceux qui, aux États-Unis mêmes, s’opposaient aux bombardements massifs du Nord Vietnam initiés par les Présidents
Johnson et Nixon. D’autres évaluations plus récentes de ce rapport, comme celle de Richard Overy, contestent la manière dont l’efficacité de la guerre aérienne y est
contestée. Selon R. Overy, les attaques lancées par les Alliés ont bien enclenché l’effondrement industriel du IIIe Reich, notamment lorsque les bombardements visaient
essentiellement des cibles industrielles stratégiques. L’Allemagne avait besoin d’huile synthétique (produite par hydrogénation du charbon) pour couvrir les trois quarts de sa consommation : l’offensive menée de mai à septembre 1944 a coûté à l’Allemagne 90 pour cent de sa production d’huile synthétique8. En empêchant le transport du carburant,la destruction des voies ferrées a limité l’utilisation des moyens de défense allemands :
les bombardements alliés en ont été d’autant plus efficaces, davantage de stocks de carburant ont été détruits, etc., etc. Comment aurait évolué la production allemande si les bombardements alliés n’avaient pas eu lieu ? Il est impossible de le savoir précisément.
Toutefois, la production allemande n’a commencé à baisser qu’au deuxième semestre de 1944, et il est admis qu’une partie de ce déclin est survenu après que les troupes
soviétiques se soient finalement rendues maîtres des gisements de pétrole roumains, et alors que le Reich livrait d’énormes batailles sur deux fronts.
Il n’en demeure pas moins que l’argument selon lequel les bombardements ont été contreproductifs (idée défendue par certains de leurs critiques) paraît aussi simpliste que
son contraire, à savoir que les bombardements auraient pu, à eux seuls, venir à bout du IIIe Reich (comme le soutenait le général Harris). Intuitivement, il ne paraît pas illogique de penser que les attaques continues et massives lancées contre un pays densément peuplé ont eu de lourdes répercussions sur les transports et la production, tout en épuisant les ouvriers qui passaient leurs nuits à chercher à se mettre à l’abri des bombes. Certes,
cette stratégie était coûteuse : il n’était pas facile de remplacer les pilotes, et 140 000 Britanniques et Américains sont morts lors de ces opérations, qui ont en outre entraîné la perte de 21 000 avions. Cette stratégie a également eu un coût dans le Pacifique. Il est vrai que les pilotes de bombardiers ont été moins nombreux à trouver la mort lors de combats contre les défenseurs japonais (le Japon étant largement dépourvu de moyens de
défense); par contre, le bilan fut lourd en termes de vies humaines et d’efforts nécessaires pour capturer les lointaines bases insulaires à partir desquelles les avions pouvaient atteindre les principales îles de l’archipel nippon. Cela étant, les bombardements effectués avec des appareils plus légers ont été terriblement meurtriers, avant même que les Américains aient lâché leurs deux bombes atomiques.
Peut-être est-il utile de faire ici la part entre les arguments en faveur des bombardements tels qu’ils ont été avancés avant le Débarquement allié, puis après
laguerre. Entre 1940 et 1942, la Grande-Bretagne a été incapable de faire intervenir une contre-force en dehors de l’Afrique du Nord, sauf dans les airs. La « nécessité » militaire reste en général un facteur très subjectif. Pourtant, Churchill estimait (à raison, je crois)
qu’il était important pour son pays d’infliger des dommages à l’ennemi au moment où il avait dû quitter le continent, où ses troupes déployées en Afrique étaient en difficulté et où il était (jusqu’en juin 1941) sans allié de poids. Après l’entrée en guerre de la Russie,
les bombardements ont permis aux Britanniques de prétendre qu’ils apportaient, eux aussi, une contribution positive à la défaite de Hitler. Comme le relève R. Overy,
toutefois, le recours de Churchill aux bombardements en 1942 a été provoqué par les propos de Staline qui raillait le peu d’empressement des Alliés à ouvrir un deuxième
front; de plus, cette option fut prise alors que les bombardements apparaissaient comme une regrettable diversion des forces aériennes, qui auraient pu être plus utiles ailleurs. Il est également fort probable que Dresde ait été attaquée en grande partie parce que les
Soviétiques s’étaient plaints de ce que la Grande-Bretagne et les États-Unis ne partagent pas équitablement, au cours de l’hiver 1945, le fardeau que représentaient les futures
batailles terrestres sur le territoire allemand.
Dans les premiers jours, cependant, les arguments en faveur des bombardements n’ont pas été officiellement développés en termes de morale et de vengeance. Ils
suivaient le cours, plus tortueux, des raisonnements relatifs à l’ampleur des pertes civiles qui serait acceptable pour anéantir l’industrie de guerre allemande. Bien que Harris, comme d’autres, aient estimé que la terreur en tant que telle était acceptable (puisqu’elle
devait nécessairement affaiblir la volonté de l’ennemi), les Alliés n’ont jamais admis officiellement une telle justification. Cela dit, les premières notions de dommages
collatéraux se sont elles-mêmes montrées assez élastiques (toute capacité industrielle ou de transport étant considérée comme contribuant à l’effort de guerre allemand et japonais). Jusqu’à quel point la dévastation était-elle acceptable ? En dirigeant des attaques incendiaires contre Sodome et Gomorrhe, Dieu lui-même avait accepté qu’il y
ait des victimes innocentes. Une fois le cours du courant changé, la violence était enracinée, et la capacité d’infliger des dommages – des dommages largement
indiscriminés – avait été considérablement renforcée. Seuls Hitler et Goebbels ont été assez francs pour déclarer que les V-1 et V-2 utilisés dans des phases ultérieures de la guerre avaient été effectivement conçus pour semer la terreur (d’où la présence de
l’initiale V pour « Vergeltung », qui signifie « représailles » ou « vengeance »). Ces armes ne leur ont toutefois pas permis de remporter cette bataille.
Le débat allemand et la question des tabous
Il apparaît rétrospectivement que l’élément le plus frappant des discussions suscitées par ces questions en Allemagne après la guerre réside dans l’absence relative de reproches politiques (exception faite des critiques émanant des milieux d’extrême droite) et cela,tout au moins, jusqu’à ces quelques dernières années. Malgré tous les reproches implicites contenus dans le débat sur le bombardement de cette ville, Dresde n’est jamais
devenue un autre Hiroshima. Bien sûr, le nombre de morts (malgré l’inflation due à la propagande) n’a pas été aussi considérable : 35 000, et non 70 000 ou même un million
de victimes10. Il n’est pas difficile de comprendre les raisons de ce phénomène : après la guerre, pour assurer sa sécurité contre l’alliance des forces du Pacte de Varsovie,
l’Allemagne de l’Ouest est restée dépendante des Britanniques et des Américains. Deplus, pour de nombreux « bons » Allemands de l’après-guerre, le fait de vouloir aborder le thème des souffrances endurées par les Allemands semblait avoir des relents de politiques néo-nazies. Il pouvait être acceptable que les Japonais jouent le rôle de victimes uniques à cause de la bombe atomique, cette arme aussi nouvelle que terrible; de fait, même les Japonais n’ont pas insisté sur les attaques aériennes classiques, aux effets tout aussi dévastateurs, lancées sur Tokyo en avril 1945.
Pourtant, le débat a été relancé il y a quelques années et ce, dans deux directions distinctes. Tout d’abord, la question des victimes allemandes est réapparue avec le plus d’éclat dans un ouvrage de Jörg Friedrich intitulé « Der Brand : Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945 » (L’incendie : l’Allemagne dans la guerre des bombes 19401945). Ce livre est paru à un moment où de nombreux auteurs commençaient à poser des questions sur les souffrances des Allemands pendant la guerre. La culture allemande de l’après-guerre avait-elle « réprimé » tout véritable débat sur le statut des Allemands en tant que victimes ? Cet argument a été notamment avancé par feu W. G. Sebald, spécialiste de littérature et romancier, dans des conférences présentées à Zurich et dont le texte a été publié sous le titre « Air War and Literature » (Guerre aérienne et littérature).
Dans le même contexte, Günter Grass a publié son roman « Im Krebsgang » (En Crabe)
qui raconte, par touches successives, l’histoire d’un paquebot allemand coulé dans la mer Baltique alors qu’il évacuait 9 000 réfugiés fuyant l’invasion soviétique.
L’estimation du nombre de personnes tuées à Dresde a rapidement provoqué une controverse politique.
Le chiffre de 100 000 morts a d’abord été donné; de 135 000, il est ensuite passé graduellement à 250 000,
bilan jugé crédible par David Irving dans The Destruction of Dresden (1963), cet auteur semblant finalement opter pour un total de 100 000 morts. Le régime communiste avait tout intérêt à accepter un décompte aussi approximatif, mais le nombre de morts a été révisé à la baisse à la suite d’estimations plus rigoureuses. La plaque posée au temps de l’Allemagne de l’Est à l’entrée du Zwinger, l’un des trésors architecturaux de Dresde, continue de témoigner de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle mentionne la « destruction du centre de la ville de Dresde » par les forces aériennes anglo-américaines en
février 1945, la « libération » de Dresde, lorsque les armées de l’Union soviétique ont vaincu les fascistesen mai 1945 et, enfin, la reconstruction de ce chef-d’oeuvre de l’art baroque par l’État allemand des ouvriers et des paysans. La première réévaluation érudite du nombre de victimes du bombardement de Dresde figure dans l’ouvrage de Götz Bergander, Der Luftkrieg in Dresden (1977), l’auteur citant le chiffre de 40 000 morts. L’évaluation la plus récente (entre 25 et 40 000 morts) est donnée par Frederick Taylor, Dresden : Tuesday, February 13, 1945 (Harper Collins, New York, 2004), l’auteur s’interrogeant parailleurs sur la manière dont le nombre de victimes a été grossi (pp. 443 à 448). À propos de Hambourg, voir
le récit réaliste de Martin Caidin, The Night Hamburg Died, Ballantine (New York, 1960).
Aucun de ces auteurs ne saurait être soupçonné de sympathies néo-nazies. Friedrich a écrit sur les
crimes de guerre perpétrés par des Allemands. Grass, gauchiste rebelle, a pour thème préféré la souffrance ou la survie des gens ordinaires pris dans la tourmente d’une histoire allemande à laquelle ils auraient peut-être dû résister plus tôt, mais ont omis de le faire.
W. G. Sebald a écrit des histoires mélancoliques de réfugiés juifs allemands et de leur incapacité, dans leur vie ultérieure, à surmonter l’impact des persécutions.
Manifestement, tous ces auteurs ont été émus par le nombre considérable de victimes (un demi million de morts pendant la guerre aérienne; 9 000 passagers du paquebot maudit)
et avaient besoin de permettre aux morts de finalement « s’exprimer »…
Dans son ouvrage, Jörg Friedrich tente, en multipliant les détails, de décrire la guerre aérienne du point de vue de ceux qui ont été bombardés. Ce faisant, il a brisé un
tabou virtuel qui interdisait toute discussion portant sur les quelque 500 000 civils allemands victimes des raids aériens anglo-américains entre 1940 et 1945 ainsi que sur la destruction des villes et des trésors culturels. Nous devons considérer séparément le livre de Friedrich et le problème (ou les problèmes) qu’il soulève. Dans le passage le plus émouvant de son récit, Friedrich souligne l’horreur des bombes incendiaires : les victimes
mouraient brûlées dans l’asphalte en fusion, incinérées dans des caves ou asphyxiées par le monoxyde de carbone et le manque d’oxygène. L’auteur multiplie les récits montrant les effets des gros engins explosifs et de l’effet de souffle sur le corps humain; il relève
l’importance des systèmes de guidage et de marquage des cibles à l’aide de fusées éclairantes. Larguées par milliers, les bombes incendiaires ont été les véritables
« vedettes » de la technologie. Les flammes transperçaient les toits des monuments gothiques ou Renaissance comme ceux des habitations privées. Jörg Friedrich décrit les
restes ratatinés ou carbonisés des victimes, transportés dans des paniers pour être inhumés; il rappelle la destruction des familles, les efforts de la défense civile et la dispersion des enfants (mesure haïe par la population). Il relève que les destructions ont
été aussi nombreuses pendant la dernière année de la guerre que pendant toute la période précédente : les raids dévastateurs ont frappé alors non seulement les voies ferrées mais aussi, à nouveau, certaines villes déjà bombardées plusieurs fois auparavant – et même
certaines villes, comme Dresde, Würzburg et Potsdam, apparemment détruites pour une seule raison : avoir, jusque là, été épargnées.
Bien que Jörg Friedrich évoque essentiellement les bombardements britanniques, les lecteurs américains se souviendront des terribles récits relatant le raid lancé sur Tokyo dans la nuit du 9 au 10 mars 1945; ils se souviendront aussi du bilan humain, parfois plus
lourd encore, des opérations de nos B-29 qui, dès novembre 1944, survolaient (apparemment sans rencontrer d’opposition) les villes japonaises et larguaient leurs
bombes incendiaires sur des maisons en bois. Billy Mitchell, le pionnier américain du bombardement naval, avait anticipé cela dès les années 1920, en qualifiant les villes japonaises de « plus formidables cibles aériennes jamais rencontrées dans le monde… ».
L’ouvrage de Jörg Friedrich a choqué beaucoup d’Allemands (et, à fortiori, un plus grand nombre encore de lecteurs anglais ou américains) en raison du langage provocateur, évoquant la rhétorique utilisée au sujet de la « solution finale », y compris la terminologie de l’Holocauste. Je m’interroge cependant : en incriminant le langage de
cet ouvrage, certes chargé en émotion, les lecteurs anglo-américains que nous sommes (pour qui la Seconde Guerre mondiale reste avant tout la cause militaire la plus juste), ne tentent-ils pas d’esquiver les questions soulevées ? (Les lecteurs allemands qui redoutent
le caractère apologétique implicite de l’ouvrage pouvant d’ailleurs en faire de même !)
Oui, les images que Friedrich emploie sont celles-là mêmes que nous associons habituellement à la littérature de l’Holocauste … mais des enfants et des adultes sont
effectivement morts incinérés. Le caractère fastidieux du discours ne devrait pas servir de mécanisme de défense pour se protéger contre les failles qui sont documentées.
La thèse de W. G. Sebald qui évoque la répression littéraire est, elle aussi, émaillée d’erreurs. Dans les premières années de l’après-guerre (comme le montre la
collection Volker Hage), des récits allemands des bombardements et des destructions
Ces articles traitent de manière
appropriée, je crois, les forces et les faiblesses de ces travaux, Pfeiffer mettant davantage l’accent sur les
questions militaires et politiques, Arnold sur les problèmes d’ordre moral et conceptuel. D’autres critiques
ont également relevé les déficiences de l’ouvrage de Friedrich en tant que source érudite. On se reportera,
par exemple, à la liste d’erreurs relevées par Horst Boogs dans sa contribution à l’ouvrage collectif Ein Volk von Opfern ? Die neue Debatte um den Bombenkrieg 1940-45 (Rowohlt, Berlin, 2003).
Manifestement, dans ce débat, nombre de questions déclenchent une polémique. Les questions relevant le
plus d’un certain « esprit de clocher » concernent les historiens en tant que tels. Tout d’abord, jusqu’à quel
point un historien peut-il se borner à relater ou à disséquer des positions divergentes sans faire intervenir
son propre jugement moral ? Deuxièmement, quelle sorte de rhétorique est-elle légitime dans un récit historique ? Si un vocabulaire particulier en vient à être associé avec ce que l’on admet relever de la plus abominable atrocité (comme, par exemple, le langage aseptisé utilisé par les Nazis dans leur mise en oeuvre de la « solution finale »), est-il illégitime d’appliquer ce langage à d’autres situations ? Le « manque de goût » constitue-t-il une catégorie à retenir pour qualifier les écrits historiques ? En fait, Saul Friedlaender a tenté d’aborder cette question sous l’angle inverse quand il a, en analysant le kitsch nazi, tenté délibérément de dégager les dimensions esthétiques du fascisme et du nazisme (voir Reflections of Nazism : An Essay on Kitsch and Death, Harper & Row, New York, 1984). Nous connaissons le phénomène à travers des films tels que ceux de Hans-Jürgen Syberberg (Hitler : Ein Film aus Deutschland, 1977) et de Liliana Cavani (Portier de nuit, 1974) ou des romans comme celui de Michel Tournier, Le Roi des aulnes, 1970 (paru aux États-Unis sous le titre The Ogre). Dans son ouvrage, Friedrich prétend que l’historien ne peut pas se contenter d’une histoire basée sur l’expérience vécue, aussi important qu’il puisse être de relater cette
expérience. La télévision, le cinéma et l’intérêt manifesté par la société à l’égard du témoignage des
victimes nous ont conduits à penser que l’histoire est stérile sans l’évocation de l’expérience. Or, l’histoire
ne peut pas être simplement une « excavation » de l’expérience – vieilles photos, chansons tristes, extraits
de journaux intimes, et autres reliques du passé. N’utiliser que ces vestiges équivaudrait à créer une
pathétique illusion trompeuse. Il convient – et je pense même qu’il est souvent de notre devoir – de transmettre des témoignages. Néanmoins, rendre justice aux témoins et écrire l’histoire sont deux choses bien différentes. Peut-être est-ce le début, ou la fin, de la réflexion historique, mais ce sont là deux types d’exercice distincts. Peut-être ne peut-il y avoir d’histoire sans mémoire, mais il ne peut pas non plus exister d’histoire qui ne discipline pas la mémoire.
urbaines ont effectivement été publiés. Toutefois, ni articles ni romans importants ne sont venus appuyer ces récits. Aucun dialogue allemand n’a pris forme autour de ces questions; il en est allé autrement – à l’initiative des Allemands eux-mêmes – en ce qui concerne leurs propres crimes de guerre et de génocide. Comme le relève justement
Pfeiffer, ces derniers thèmes ont nourri une littérature abondante, bien que souvent spécialisée. C’est, semble-t-il, plutôt qu’un tabou absolu, une inhibition qui a empêché de produire ou de citer du matériel concernant les souffrances des Allemands en tant que telles. Plusieurs rapports ont pourtant été consacrés à la guerre aérienne : certains ont été rédigés par les vainqueurs, d’autres sont le fruit des importants travaux de recherche
menés au centre d’histoire militaire de l’université de Fribourg15. Il est cependant rare que de tels travaux s’attardent sur l’expérience des victimes des bombardements. Certains commentateurs se sont également demandés pourquoi des Allemands non néo-nazis
n’avaient pas pu écrire plus tôt cette histoire de manière aussi graphique, ou se permettre d’en débattre plus ouvertement. La réponse proposée par Hans Ulrich Wehler et d’autres est la suivante : les Allemands avaient profondément conscience du fait que leur régime portait la responsabilité de la guerre et avait tué beaucoup plus de gens, en commettant des meurtres patents, caractérisés par le fait qu’absolument chaque mort infligée avait été
intentionnelle. Certains Allemands, je pense, ont gardé le silence non pas simplement parce qu’ils ne pouvaient pas se réconcilier eux-mêmes avec cette réalité, mais parce
qu’ils comprenaient bel et bien où avait commencé la chaîne de cette guerre si meurtrière.
« [En tant que jeunes survivants, nous n’avons fait] aucun serment de revanche contre les pilotes des bombardiers. D’une certaine manière, nous éprouvions à leur égard un certain sentiment de solidarité; ils avaient cherché à détruire ce système que nous-mêmes […]
nous avions mis en place, mais que nous n’avions pas eu la force de renverser, » écrit Peter Wapnewski16. Même Jörg Friedrich, pourtant révolté par les souffrances infligées
aux Allemands, concède que : « La destruction des villes a contribué à l’élimination de Himmler et de ses partisans, qui avaient pris en otages ces lieux, cette histoire et cette humanité, l’Allemagne et l’Europe tout entières. » Mais c’est aussi l’Allemagne qui avait pris ces otages, « ...par voie de violence ou d’adhésion, par colère, équanimité ou impuissance. Penser que l’Allemagne aurait pu être différente, n’est rien d’autre qu’une
hypothèse, un exercice théorique ». Friedrich relève cependant qu’il serait tout aussi hypothétique de se demander si la conflagration pourrait avoir été inutile : « Fallait-il que la ville d’Hildesheim soit détruite à cause de sa gare de chemin de fer ? S’agissait-il de la vraie raison et, de fait, y avait-il vraiment une raison ? Ceux qui ont allumé l’incendie ntentionnellement, mus par la colère, voulaient-ils gagner à tout prix, ou s’agissait-il là du prix à payer pour leur victoire ? Certainement, c’est là qu’ils voulaient en venir. Si
cela ne représente pas une tragédie dans l’histoire des Alliés, que représente leur succès total dans l’histoire des Allemands ? »
Certains historiens ont jugé que l’ouvrage de Friedrich était simplement démagogique et inexact. Il s’agit là d’une stratégie de compartimentation, à laquelle je
n’adhère pas. Friedrich soulève des questions graves que nous ne pouvons traiter avec sérieux si nous nous bornons à critiquer le langage provocateur de l’ouvrage ou son
manque d’équilibre. Friedrich comprend bien qu’après la défaite de 1940, aucun accord n’ayant pu être trouvé, les Britanniques semblaient n’avoir d’autre choix que de
combattre l’ennemi avec toutes les armes disponibles. La morale, comme le pensait Churchill, n’exigeait-elle pas d’infliger quelques dommages à un ennemi qui menaçait
d’envahir le pays et transformait Londres en terrain vague ? Tout homme d’État démocrate résolu à résister n’aurait-il pas adopté cette stratégie ? Il a cependant manqué ce point à partir duquel la stratégie aurait dû changer – comme Arthur Harris avait éclaré qu’elle devrait le faire – en passant de l’attaque déterminée de certaines cibles (voies ferrées ou sites industriels) à des bombardements ayant une toute autre finalité ?
Un tel changement n’est d’ailleurs pas surprenant. Comme Friedrich le comprend bien, la guerre aérienne est devenue une guerre de Vergeltung, c’est-à-dire de vengeance, dans
laquelle les Britanniques sont allés bien au-delà des destructions qu’ils avaient eux-
mêmes subies (de la même manière, la riposte américaine contre le Japon a dépassé de beaucoup les pertes subies à Pearl Harbour, si souvent citées comme justification). La
guerre aérienne a résulté tout autant d’un esprit de vengeance que d’une stratégie. Quoi qu’en dise Peter Wapnewski, de nombreux Allemands ont attendu avec impatience les armes « V », promises par Goebbels, qui devaient permettre d’exercer des représailles.
L’objet de la controverse n’est pas seulement le succès militaire. Comme je l’ai mentionné plus haut, la critique de l’efficacité des bombardements contenue dans le
rapport sur les bombardements stratégiques américains ne paraît plus défendable. Dès l’été et l’automne 1944, la machine de guerre allemande avait été largement neutralisée.
Les défenses aériennes perdaient de leur puissance et la production commençait à baisser fortement. Assurément, disent les historiens qui les défendent, les bombardements
avaient précipité cet effondrement, avec les tonnes d’explosifs déversées sur le pays. À cela, les critiques peuvent répondre de deux façons : d’une part, d’autres facteurs (et notamment des revers militaires sur le terrain) ont joué un rôle déterminant; d’autre part,
alors que ce qu’ils nommaient « bombardements de précision » manquaient justement de précision, les Alliés n’avaient pas à bombarder les villes de manière si indiscriminée.
J’estime personnellement qu’un autre succès peut être porté au crédit des bombardements. La démonstration de l’impuissance de la défense nazie explique en effet
en partie qu’il n’y ait eu, après la Seconde Guerre mondiale, aucun mouvement revanchiste réel, aucun nationalisme qui se serait rebellé. Là encore, cependant, une défaite sans immolations aurait pu ouvrir la voie au même succès après la guerre. Non, la question tient vraiment au prix du succès : elle demeure au centre des discussions, et elle doit continuer à être débattue tant par les historiens que par tous ceux qui ont été
directement impliqués.
La non-existence d’un débat anglo-américain et la question des représailles
Ce qui me frappe, à propos de ces débats c’est tout d’abord leur peu de retentissement en Allemagne. Jusqu’ici, et malgré tout ce que l’on entend à propos de la propension allemande à la victimisation, la question des bombardements n’a jamais été un thème politique important ou vivement débattu. Elle n’a provoqué dans le public ni sympathie ni prise de conscience semblables à celles que la bombe d’Hiroshima a fait naître au Japon.
La culture civique allemande a abandonné l’attitude tu quoque qu’elle avait encore largement conservée tout au long des années 1950. Oui, pendant longtemps, les récits de victimes sont restés nombreux – spécialement parmi les réfugiés venus de Prusse orientale, des territoires passés sous le contrôle de la Pologne après 1945, ainsi que de la
région des Sudètes. L’ouvrage de Friedrich peut être vu comme une continuation de cette tendance à avoir pitié de soi et, souvent, de l’apologie émanant des milieux de droite. En fait, les étrangers sont enclins à écouter ces plaintes avec une sympathie qui était exclue
en Allemagne jusqu’à ces tout derniers temps, sauf du côté de l’extrême droite. Les regrets exprimés par Vaclav Havel à propos de l’expulsion des Allemands des Sudètes
ont illustré cela de manière frappante. Cela dit, ni le livre de Friedrich ni les séries d’articles et de commentaires parus dans la presse à son sujet n’ont débouché sur une tentative importante d’introduire l’idée d’une équivalence, sur le plan moral, entre les
crimes de guerre allemands et les bombardements alliés. Je pense que cette réticence est due à une reconnaissance profonde du fait que l’on ne peut pas se livrer à une sorte de comptabilité morale, mettant en regard une série d’atrocités et ce qui pourrait être considéré comme en en constituant une autre. La récente célébration, le 8 mai 2005, de la Journée de la Victoire en Europe démontre de manière plus éclatante encore que les Allemands souhaitent éviter toute exploitation politique de la question de la guerre aérienne. Il y a quelques années, ils avaient souvent tendance à dire que leur pays ne pouvait pas célébrer le 8 mai en tant que Journée de la libération, car cette date était aussi celle d’une défaite nationale catastrophique. Dernièrement, lors de cette commémoration,
à Moscou et ailleurs, leur position avait complètement changé : les Allemands y ont participé comme des Allemands qui pouvaient accepter sans réserves les résultats du 8
mai 1945. La culture politique qui permet de surmonter de cette façon un sentiment national conventionnel n’est pas de nature à appuyer les courants sous-jacents qui
parcourent l’oeuvre de Friedrich. Jürgen Habermas pourrait être fier : le patriotisme constitutionnel prévaut même dans l’Allemagne réunifiée.
Un autre fait me paraît cependant tout aussi digne d’intérêt : l’absence de débats aux États-Unis, sinon en Grande-Bretagne. La culture politique américaine permet, je crois, un examen beaucoup moins tolérant (à ce stade, tout au moins) des erreurs commises au début de la Seconde Guerre mondiale. Il est vrai que les Américains ont
entamé une expiation nationale de plusieurs événements concernant les Indiens, l’esclavage, le lynchage et la ségrégation des Afro-américains ainsi que l’internement,
pendant la Seconde Guerre mondiale, des Américains d’origine japonaise de la Côte Ouest. Par contre, le souvenir de la « bonne guerre » est encore trop frais dans leur mémoire, ou reste une perception encore trop nécessaire pour faire l’objet d’un même
examen hautement émotionnel. La vive polémique suscitée en 1955 par l’exposition sur le bombardier « Enola Gay » (aussi imparfait qu’ait pu être le matériel explicatif) a
montré la grande résistance du public à ce type d’examen18. On peut débattre de Hiroshima et de Nagasaki, mais la guerre aérienne conventionnelle reste au-delà de toute réévaluation populaire d’envergure. Les histoires récentes des pilotes de bombardier américains – spécialement le récit de Stephen Ambrose sur les raids des B-24 Liberator – sont coulées dans le moule héroïque. Intitulé « Wings of Morning » (Les ailes du matin),
le récit émouvant de Thomas Childers (dont, de toute évidence, Ambrose s’est inspiré, bien qu’il ne l’ait jamais reconnu) raconte la guerre de son oncle, pilote de B-24. Thomas Childers ne cherche pas non plus à mettre en question le bien fondé des raids de bombardement jusqu’à et y compris avril 1945. Il a cependant explicitement écrit un livre sur une expérience subjective – l’expérience très dangereuse que des Américains
ordinaires ont vécue en exécutant les ordres reçus – et il a promis d’écrire un second volume sur l’expérience de la guerre vécue « au sol ». Personne, toutefois, n’a encore
suggéré que si les soldats américains sont censés résister à des ordres immoraux, ou si les commandants peuvent être sanctionnés pour avoir donné de tels ordres, tout aspect de la guerre aérienne devrait relever de cette catégorie morale.
Les débats engagés sur la guerre aérienne – tant parmi les Allemands que parmi les Britanniques et les Américains – révèlent en fait qu’en grande partie, la discussion sur
la légitimité des bombardements aériens massifs, ou sur leur justification au nom de la « juste guerre », était hors sujet. Dans les grandes guerres nationales, même lorsque les sociétés étaient contrôlées par un régime totalitaire et que l’on estimait que les citoyens
ne pouvaient avoir aucune influence sur leurs dirigeants, les représailles ont été acceptées. Comme l’a écrit en 1942 un parlementaire britannique, membre du Parti
libéral, « je suis pour le bombardement des quartiers des villes allemandes où vit la classe ouvrière. Je suis un disciple de Cromwell. Je crois comme lui qu’il faut ‘tuer au nom de Dieu’, car l’on ne pourra pas faire comprendre les horreurs de la guerre à la population civile allemande avant qu’elle-même les ait connues ». Bien sûr, parler de
bombardements « à but pédagogique » ne signifie pas qu’une telle leçon puisse être infligée à des enfants de cinq ans. Ce sont les parents allemands qui devaient recevoir une leçon en voyant mourir leurs jeunes enfants innocents. Sans aller jusqu’à défendre un tel degré de colère vertueuse, nous sommes enclins à accepter l’idée de représailles. La menace de représailles est certainement devenue acceptable pendant la Guerre froide,lorsque des opérations massives de vengeance étaient conditionnées par la « dissuasion …/ la destruction mutuelle assurée ». La stratégie « de seconde frappe » (ou de missiles
pointés sur les grandes villes ennemies) a été largement acceptée jusqu’aux années 1980, lorsque le consensus sur la dissuasion nucléaire a commencé à se dissiper.
Cela étant, la plupart d’entre nous estiment que de telles représailles doivent être menées de manière aléatoire. Il reste inacceptable de prendre individuellement pour
cibles des civils. Ce qui est acceptable, ce sont des représailles menées avec la certitude statistique qu’un pourcentage donné de civils trouvera la mort. En fin d’analyse, ceux d’entre nous qui seraient prêts à accepter la guerre aérienne disent que, dans certaines
conditions, il peut être nécessaire de brûler des bébés. Même si des enfants ne sont pas explicitement pris pour cibles, nous connaissons tous assez bien les statistiques pour savoir que notre choix (influencé par l’histoire) sera de tuer ceux dont aucune théorie d’une société en guerre ne peut plausiblement prétendre qu’ils ont opté pour la guerre.
« La vengeance m’appartient » aurait déclaré Dieu. La vengeance, cependant, nous appartient aussi – y compris la mort de civils aussi longtemps que les victimes ne sont pas personnellement désignées. Cela reste curieux. Pourquoi est-il plus acceptable que, par exemple, cinq pour cent de la population d’une ville comptant un demi million d’habitants soient tués (soit 25 000 personnes) pour autant que l’on ne précise pas de quels cinq pour cent il s’agit, alors que le fait de fusiller sur le champ 50 otages est inacceptable ? Il en est pourtant ainsi. La question n’est pas vraiment celle du caractère aléatoire des attaques : le terroriste qui s’apprête à frapper ignore quels adolescents se trouvent par exemple dans tel café de Jérusalem, ou qui se trouvera déjà sur son lieu de
travail au World Trade Centre. Le terroriste inflige la mort comme s’il s’agissait d’une loterie. La distance est-elle en question ? Celui qui tue « en gros plan » est-il considéré comme plus responsable que celui qui sème la mort à distance ? Quelle que soit la source de ces scrupules, et quelle que soit la cause de la mort (bombardement, blocus, radiations et ainsi de suite), une mort dont la victime n’est pas désignée est plus acceptable qu’une mort dont la victime est désignée. Est-il éthiquement plus acceptable de traiter la vie et la
mort comme s’il s’agissait d’une loterie que d’infliger la mort à des groupes désignés de personnes ? Et pourquoi est-il plus acceptable d’excuser, en tant que moyen de guerre, le bombardement massif de villes et de cités en ayant la certitude statistique de tuer des victimes innocentes, et de condamner le terrorisme qui tue délibérément des civils
innocents, traités comme de simples pions dans une réponse politique ?
Deux réponses sont possibles, mais aucune n’est très satisfaisante. La première est
que le terrorisme a spécifiquement pour but de tuer des innocents; lors des bombardements de villes, la mort de civils est simplement acceptée. L’historien, bien sûr,
n’est pas un éthicien. Mais jusqu’à quel point une telle distinction est-elle valable ? La seconde réponse possible, c’est que les régimes malveillants gardent leurs propres citoyens en otages et sont responsables de la mort d’« innocents », comme le sont ceux qui s’efforcent d’abattre de tels régimes. Les Allemands ont commencé la guerre, ou plutôt, leur Führer l’a fait. Bon, cela sonne bien, mais ne diminue en rien la complicité de ceux qui ont largué des bombes sur leur pays. À quel âge devenait-on nazi ou même sympathisant ? Certainement pas avant d’avoir 4 ans, 5 ans, 6 ans, ou…ou… Les lecteurs
attendent des historiens (à juste titre, je pense) qu’ils assument une responsabilité
« secondaire » lorsqu’il s’agit d’approuver ou de désapprouver les décisions de ceux qui ont eu des choix difficiles à faire. Dire que l’ouvrage de Friedrich est affaibli par un manque d’équilibre ou le caractère provocateur du langage utilisé ne suffit pas à nous
tirer d’affaire. En tant que bons libéraux, nous pourrions plausiblement prétendre que nos hommes d’État et nos pilotes pourraient avoir tué moins de bébés ou de non-combattants (c’est probablement ce que pensent la plupart d’entre nous après avoir lu l’ouvrage de Friedrich). Pourtant, je me trouve finalement contraint d’affronter des inconsistances et des croyances que j’aurais préférées éviter d’affronter. Les préceptes du jus in bello
restent, au mieux, des principes directeurs asymptotiques, jamais complètement respectés, souvent enfreints en toute hypocrisie. Mais avons-nous d’autres choix ?